Suivre les trajectoires de vie pour mieux comprendre la santé mentale des jeunes
Suivre les trajectoires de vie pour mieux comprendre la santé mentale des jeunes
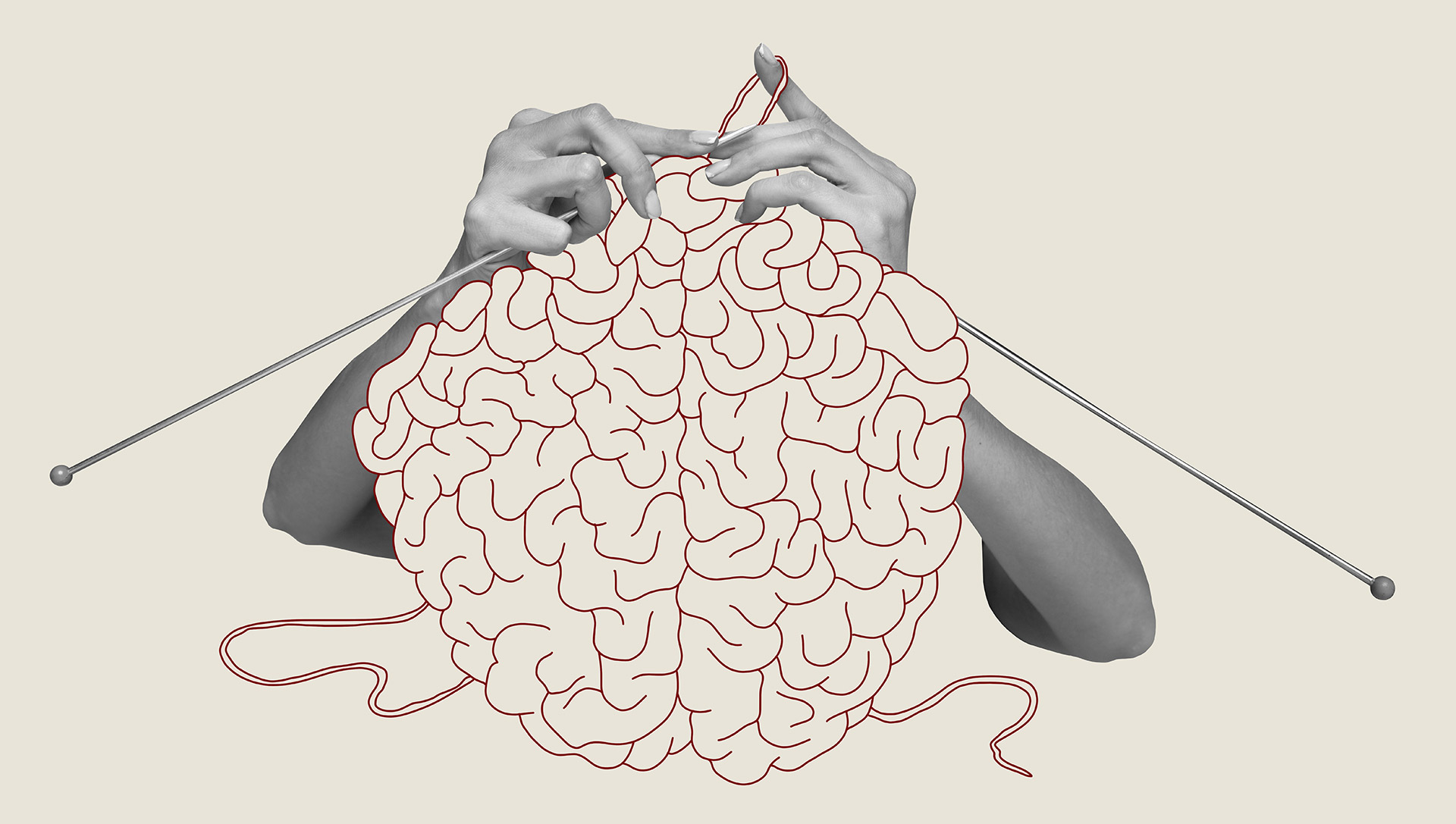
En France, la santé mentale des jeunes inquiète. Selon l’enquête EnCLASS, conduite en 2022 auprès de plus de 9 300 élèves du secondaire1, si huit adolescents sur dix se disent en bonne santé, les risques de dépression détectés chez les collégiens progressent nettement. Entre 2018 et 2022, la proportion de garçons présentant plus de sept symptômes dépressifs a augmenté de 5,2 % à 6,9 %, et celle des filles de 13,4 % à 21,4 %. Les symptômes les plus déclarés sont un manque d’énergie, un sentiment de découragement et des difficultés à se concentrer. Sur la même période, les pensées suicidaires ont également progressé : de 13,3 % à 17,4 % chez les garçons, et de 24,2 % à 30,9 % chez les filles, soit près d’une sur trois. Globalement, les filles déclarent une santé mentale et un bien-être moins élevés que les garçons, un écart qui se creuse à partir de la classe de 4ᵉ avant de se stabiliser au lycée. Pandémie de Covid-19, conflits armés, attentats, crises climatique et environnementale, pression scolaire, expositions à internet et à l’utilisation des médias sociaux sont autant de facteurs de risques qui pourraient expliquer la détérioration du bien-être des adolescents et des jeunes adultes. En 2020, à l’issue du premier confinement, 22 % des 15 – 24 ans déclaraient des symptômes de dépression contre 13 % dans l’ensemble de la population2, un chiffre deux fois plus élevé qu’avant la pandémie. Un an plus tard ils étaient encore 14 %. Or, 75 % des affections psychiatriques débutent avant 25 ans et la moitié avant 15 ans. Dans un cas sur deux, elles persistent au cours de la vie.
Identifier les déterminants précoces de la santé mentale en suivant les trajectoires de vie
« On observe ces dernières années une hausse des troubles anxieux et dépressifs, et davantage de recours aux soins pour des gestes suicidaires chez les adolescents. De fait, depuis la pandémie, la situation n’est pas revenue à son état d’avant. Modifiant et bouleversant nos modes de vie, la pandémie a agi comme un révélateur voire un accélérateur de la dégradation de la situation », analyse l’épidémiologiste et directrice de recherche à l’Inserm Maria Melchior qui étudie la fréquence des problèmes de santé dans les populations et de leurs déterminants. Au-delà des seuls facteurs contextuels, pour Maria Melchior, la position sociale et économique, les difficultés d’insertion, le réseau ou le soutien social, la compétition scolaire, le genre, les discriminations influencent aussi la santé mentale des jeunes. Pour comprendre comment ces déterminants sociaux et contextuels s’articulent, son équipe s’appuie sur des cohortes, des groupes de personnes suivis pendant des années, parfois depuis la naissance : TEMPO, qui suit depuis 2009 un échantillon d’adultes sur leur santé mentale, leurs consommations et leurs parcours de vie ; EDEN, une cohorte mère-enfant lancée dans les années 2000 à Nancy et Poitiers, centrée sur les déterminants précoces du développement physique et psychologique de l’enfant ; ou ELFE, une cohorte nationale de 18 000 enfants, suivis depuis 2011. « Les financements de l’ANR nous ont permis de constituer et de poursuivre TEMPO, et d’exploiter les données riches et complexes d’ELFE. Ces cohortes offrent une vision unique des liens entre conditions de vie et troubles psychiques », explique Maria Melchior.
La précarité économique, un facteur de risque important
Véritables laboratoires sociaux, ces cohortes nourrissent ainsi des projets de recherche. Entre 2013 et 2016, le projet ANR SOCIALRISK_MH - Déterminants sociaux des trajectoires de santé mentale depuis la petite enfance, porté par l’épidémiologiste, a montré comment la pauvreté, les ruptures familiales ou les événements stressants précoces influencent durablement le risque de dépression ou de consommation de substances au cours de la période périnatale et dans la petite enfance. « La pauvreté est un facteur de risque très important. Sortir les gens de la précarité, en particulier les familles monoparentales, dont plus de 80 % sont tenues par des mères seules et un tiers vivent sous le seuil de pauvreté, ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur leur santé mentale », insiste-t-elle. Plus récemment, en 2020, en pleine crise sanitaire, elle a mené le projet TEMPO-COVID-19, sur l’impact de l'épidémie COVID-19 et du confinement sur la santé mentale et les conduites addictives en population générale, qui a exploité les données de TEMPO. Il a montré que l’anxiété et la dépression se sont aggravées pendant la pandémie, en particulier chez les jeunes déjà fragilisés par des difficultés économiques ou un faible soutien social. Par ailleurs, leurs résultats montrent aussi qu’entre 2018 et 2020, la plupart des participants n'ont pas modifié leur consommation d’alcool (une préoccupation des autorités sanitaires avec, notamment, l’émergence du phénomènes d’« apéros Skype »), tandis que d’autres ont modérément (24,4 %) ou fortement (12,4 %) augmenté leur consommation.
Mieux repérer les signaux d’alerte
Mais détecter un trouble psychique dès l’adolescence n’est pas aisé. « C’est une période marquée par une forte labilité émotionnelle et une immaturité cérébrale », rappelle la chercheuse. Elle recommande de prêter attention à certains signes tels que l’isolement, la perte d’intérêt pour les activités habituelles, une baisse des résultats scolaires, des prises de risques répétées (alcool, cannabis). « Ce qui doit inquiéter, le plus tôt possible, c’est la régularité et la durée de ces comportements et la perte de plaisir dans les activités. Un adolescent qui va mal, qui a des pensées suicidaires, ne peut pas attendre six mois ou un an avant d’être pris en charge. Tout ne requiert pas forcément une médicalisation, mais passer à côté d’un trouble qui émerge peut avoir des conséquences sur le très long terme ». Plus récemment, Maria Melchior participe au projet européen IMPROVA s’appuyant sur les cohortes EDEN et ELFE qui s’applique à identifier les facteurs de risque et évaluer l’efficacité d'une intervention numérique de promotion de la santé mentale des jeunes en milieu scolaire. « A travers une application pour les jeunes, des sites dédiés pour les parents et les professeurs, nous avons développé des modules et des outils pour aider chacun et chacune à affronter certaines situations. L’objectif est que les adultes apprennent à mieux repérer les enfants et les adolescents qui ne vont pas bien. L’adolescence est une période charnière pour la santé mentale future », précise Maria Melchior.
L’environnement, un levier de prévention
Les données issues des cohortes montrent aussi que des facteurs protecteurs dès la petite enfance existent : modes de garde de qualité, soutien aux jeunes parents, congés parentaux plus longs, implication du père dès la naissance. « Le fait d’aller en crèche ou que le père prenne un congé paternité (ndlr : de 28 jours depuis juillet 2021) peut jouer un rôle favorable, même si cela ne compense pas les autres risques », explique-t-elle. Maria Melchior souligne aussi l’importance de la santé psychique des parents : « Lorsque la mère est déprimée, les risques sont démultipliés pour l’enfant. Mais si le parent est pris en charge, on améliore aussi l’état de l’enfant ». Ces constats rejoignent les objectifs de la stratégie nationale des “1 000 premiers jours”, qui vise à accompagner les familles dès la grossesse et à favoriser un environnement propice au développement psychique de l’enfant. En reliant trajectoires de vie et santé mentale, les cohortes sur lesquelles s’appuie la chercheuse offrent ainsi un levier d’actions pour les politiques de santé publique : elles permettent de cibler la prévention dès l’enfance, d’évaluer l’impact des politiques mises en œuvre et d’imaginer celles susceptibles de réduire les inégalités sociales. « La santé mentale est un défi pour le XXIᵉ siècle : il reste beaucoup à faire en matière de repérage et de prévention, notamment face aux violences et maltraitances vécues dans l’enfance », conclut Maria Melchior qui poursuit toujours l’analyse des données issues des différentes cohortes suivies dans le temps.
Ces dernières années, la parole sur la santé mentale commence à se libérée, notamment sur les réseaux sociaux. Là où pour les générations précédentes, ces troubles étaient largement tus, des personnalités comme les artistes Billie Eilish ou Stromae, les athlètes comme Simone Biles ou Michael Phelps les évoquent désormais ouvertement. Aussi, au cinéma et dans les séries, les personnages confrontés à la dépression, au trouble bipolaire, la schizophrénie ou à l’autisme sont plus visibles. Ces prises de parole publiques - et plus largement accessibles - contribuent à briser les tabous. Elles offrent, aussi, aux jeunes de nouveaux modèles d’identification.
1 Selon l’enquête nationale de Santé publique France parue en 2024 sur la santé mentale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS), menée par l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec l’Education nationale.
2 D’après les données de l’étude ÉpiCov, menée conjointement par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la Direction de la recherche et des études statistiques (Drees) du ministère des Affaires sociales auprès d’un échantillon représentatif de plus de 100 000 personnes https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
Santé mentale : avec l’ANR et France 2030, la recherche se mobilise - Dossier d'actus
Depuis ses débuts, l’ANR s’est mobilisée pour répondre aux défis que représentent la santé mentale et la prévention, la détection précoce, la prise en charge ou encore l’identification de déterminants contextuels et sociaux des maladies psychiques, et contribuer ainsi à l’élaboration de leviers d’action pour les politiques publiques.
Santé mentale : avec l’ANR et France 2030, la recherche se mobilise


